Curious Expedition ranime le souffle des grandes expéditions, convoquant l’esprit d’un XIXe siècle rêvé, entre quête de gloire et fascination pour l’inconnu. Maschinen-Mensch érige un roguelike où chaque expédition s’écrit comme une traversée vers la légendaire pyramide dorée, sous la bannière de figures mythiques telles que Darwin ou Marie Curie.
La promesse est limpide : stratégie, gestion, survie, et choix déterminants dans un univers où chaque pas fait vaciller la raison. Le portage sur Nintendo Switch, en avril 2020, ouvre la voie à l’aventure nomade, mais la magie opère-t-elle encore, ou se dilue-t-elle dans la routine des mécaniques et des automatismes ?
Esprits en exil, conquête de la légende
 Dans Curious Expedition, chaque aventure débute au cœur d’un XIXe siècle hanté par le mystère, là où les grands explorateurs disputent à la folie les ultimes terres vierges du globe. Le jeu impose d’entrée une atmosphère tendue : vous prenez la tête d’une expédition, choisissez vos compagnons – savants, guerriers, indigènes ou bêtes de somme – chacun doté de compétences uniques capables de transformer le moindre détour en salut ou en naufrage.
Dans Curious Expedition, chaque aventure débute au cœur d’un XIXe siècle hanté par le mystère, là où les grands explorateurs disputent à la folie les ultimes terres vierges du globe. Le jeu impose d’entrée une atmosphère tendue : vous prenez la tête d’une expédition, choisissez vos compagnons – savants, guerriers, indigènes ou bêtes de somme – chacun doté de compétences uniques capables de transformer le moindre détour en salut ou en naufrage.
L’objectif se dessine avec la clarté d’un mirage : atteindre la pyramide dorée, relicte d’un âge ancien, au prix d’une traversée qui mettra à l’épreuve les ressources, la cohésion et la santé mentale du groupe. Chaque décision — sacrifier du matériel, explorer un temple au risque d’une malédiction, négocier ou trahir des autochtones — façonne le destin de l’équipe, avec pour constante la pression d’un équilibre fragile. La gestion de la santé mentale s’impose comme la clé de voûte : la progression dans des biomes hostiles, l’enchaînement d’événements stressants ou la perte d’un allié minent peu à peu l’esprit des explorateurs. La moindre erreur se paie cash : hallucinations, paniques, ruptures, jusqu’au naufrage de l’expédition entière.
Le choix des figures historiques ne relève pas de l’anecdote : chaque explorateur emblématique insuffle un style de jeu distinct, pousse à expérimenter d’autres stratégies, et offre une rejouabilité sincère sur les premiers runs. Le plaisir de la découverte, la gestion des ressources, le calcul du risque, le goût du pari s’entrelacent dans un flux de décisions lourdes de conséquences. Même en mode facile, l’insouciance ne pardonne rien : le jeu sanctionne la moindre imprudence, et une aventure prometteuse peut basculer à tout instant dans le désastre, révélant ainsi la férocité de la survie.
Le hasard aux dés, la stratégie sous contrainte
 Le cœur mécanique de Curious Expedition bat au rythme d’un système de combat où la fortune impose sa loi. À chaque rencontre — attaque d’animaux sauvages, embuscade de tribus, événement imprévu — le jeu impose le passage par les dés. Ces lancers, qui symbolisent attaques, soins, protections et capacités spéciales, introduisent une part d’aléatoire qui s’empare du contrôle du joueur. Même la préparation la plus méticuleuse se trouve suspendue à un jet hasardeux : un tirage chanceux retourne une situation, une suite de dés défavorables ruine une expédition en un instant.
Le cœur mécanique de Curious Expedition bat au rythme d’un système de combat où la fortune impose sa loi. À chaque rencontre — attaque d’animaux sauvages, embuscade de tribus, événement imprévu — le jeu impose le passage par les dés. Ces lancers, qui symbolisent attaques, soins, protections et capacités spéciales, introduisent une part d’aléatoire qui s’empare du contrôle du joueur. Même la préparation la plus méticuleuse se trouve suspendue à un jet hasardeux : un tirage chanceux retourne une situation, une suite de dés défavorables ruine une expédition en un instant.
La dimension stratégique existe : la constitution de l’équipe, le choix de l’itinéraire, l’utilisation des objets, la prise en compte des compétences spécifiques de chaque membre. Mais face à la dictature du hasard, la maîtrise s’effrite. La frustration s’installe lorsque l’issue d’un affrontement, même anticipé, se résout par une suite de lancers défavorables, annihilant la progression et condamnant parfois toute la dynamique du voyage.
Ce système, loin de briser la tension, la cristallise : chaque combat devient une prise de risque, chaque victoire semble arrachée à la loterie, chaque échec suscite le doute. La profondeur stratégique s’efface derrière la fatalité : la routine s’installe, et le plaisir de la découverte cède le pas à la résignation. Ce choix de design, s’il colle à l’esprit du roguelike, prive le joueur de la sensation d’avoir toujours la main sur son destin.
Pixels d’ailleurs, mirages et limites d’un monde
 Curious Expedition opte pour une direction artistique en pixel art rétro, qui réveille la nostalgie des jeux d’aventure des années 90 tout en affichant une patte singulière. Chaque biome – jungle, désert, toundra ou île mystérieuse – présente ses propres codes visuels, sa palette de couleurs, ses architectures de villages ou de temples oubliés. Le charme opère dans les premières heures : l’exotisme, l’impression de s’aventurer sur une carte inexplorée, la découverte d’animaux fabuleux ou d’autochtones inconnus. Les portraits stylisés des personnages, les petits détails animés sur la carte, ajoutent une touche de vie à chaque tableau.
Curious Expedition opte pour une direction artistique en pixel art rétro, qui réveille la nostalgie des jeux d’aventure des années 90 tout en affichant une patte singulière. Chaque biome – jungle, désert, toundra ou île mystérieuse – présente ses propres codes visuels, sa palette de couleurs, ses architectures de villages ou de temples oubliés. Le charme opère dans les premières heures : l’exotisme, l’impression de s’aventurer sur une carte inexplorée, la découverte d’animaux fabuleux ou d’autochtones inconnus. Les portraits stylisés des personnages, les petits détails animés sur la carte, ajoutent une touche de vie à chaque tableau.
Mais la magie s’étiole à mesure que les expéditions s’enchaînent. Les environnements, bien que variés dans leur intention, finissent par se répéter, la richesse graphique cédant la place à une forme de routine visuelle. Le pixel art, efficace pour poser une ambiance, peine à se renouveler sur la durée : la diversité promise par la génération procédurale laisse place à la familiarité des motifs, des couleurs, des structures.
Côté bande-son, la discrétion est de mise. Les thèmes musicaux, sobres et cycliques, accompagnent la progression sans jamais s’imposer, contribuant à une ambiance de fond mais peinant à insuffler l’ampleur épique que le cadre suggère. Les bruitages, eux, soulignent l’essentiel : le pas dans la boue, le rugissement d’un animal, le crépitement du feu. L’habillage sonore, s’il ne brise jamais l’immersion, reste cantonné à un rôle d’accompagnement, sans éclat mémorable.
Odyssée fragmentée, horizon qui se referme
 La rejouabilité constitue la promesse fondamentale de Curious Expedition. À chaque partie, la carte se recompose, les dangers se déplacent, les rencontres se renouvellent. Les objectifs varient peu : explorer, survivre, dénicher la pyramide dorée, gérer la faim, la santé mentale et les imprévus. Mais derrière ce vernis de diversité, la répétition s’installe. Les missions adoptent vite un schéma récurrent : progression, prise de risque, fouille de temples, affrontement ou évitement des menaces, négociation ou conflit avec les tribus.
La rejouabilité constitue la promesse fondamentale de Curious Expedition. À chaque partie, la carte se recompose, les dangers se déplacent, les rencontres se renouvellent. Les objectifs varient peu : explorer, survivre, dénicher la pyramide dorée, gérer la faim, la santé mentale et les imprévus. Mais derrière ce vernis de diversité, la répétition s’installe. Les missions adoptent vite un schéma récurrent : progression, prise de risque, fouille de temples, affrontement ou évitement des menaces, négociation ou conflit avec les tribus.
La génération procédurale, censée garantir la surprise, se heurte à la réalité des motifs qui reviennent : villages similaires, animaux déjà croisés, temples dont les énigmes et récompenses s’uniformisent. Après quelques heures, la découverte s’efface au profit de l’optimisation, la tension initiale fait place à la routine, et le sentiment d’épopée se dilue.
Le choix de figures historiques et la variété des compétences insufflent un peu de renouveau, mais ne parviennent pas à masquer une usure mécanique. Les modes de difficulté proposent un défi progressif, mais l’essence du jeu reste prisonnière de ses limites structurelles. La soif d’exploration cède alors devant la lassitude, et le plaisir de la prise de risque s’émousse sous le poids d’une aventure trop vite balisée.

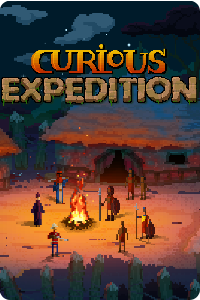

0 commentaires